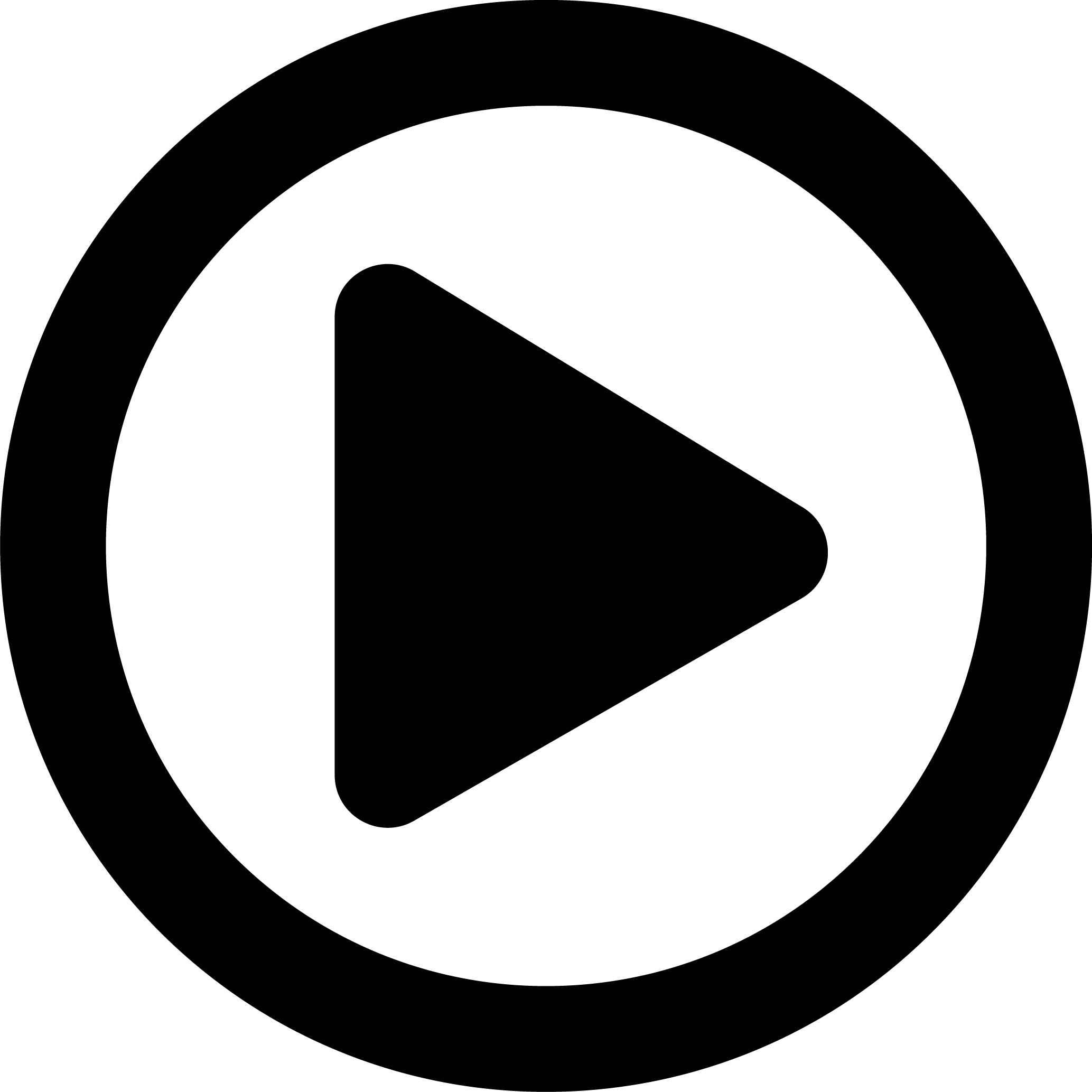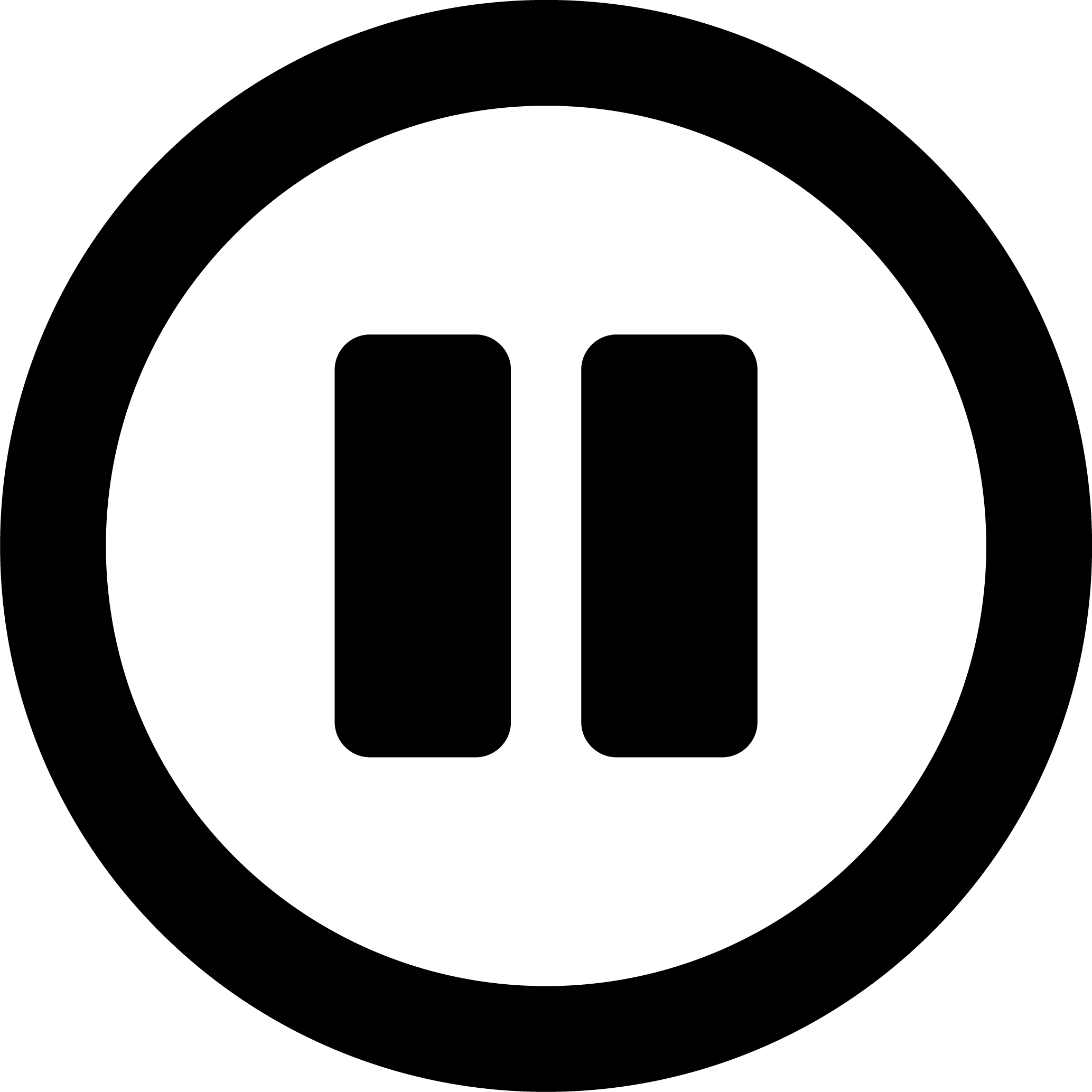Angélique Kidjo, lauréate d'un Grammy et ambassadrice de l'UNICEF, nous parle du métissage des cultures, de l'autonomisation des femmes et des jeunes, et de sa mission à faire entendre la voix de l'Afrique dans le monde.
Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir musicienne et comment votre éducation au Bénin a-t-elle influencé votre style artistique ?
Je n'ai pas décidé de devenir musicienne. C'est la musique qui m'a choisie, je dirais. J'ai grandi dans une maison où la musique était au centre de notre vie, aux côtés du sport. Les deux choses les plus importantes pour mes parents étaient l’éducation, la musique et le sport.
J'ai grandi en écoutant beaucoup de musiques venant du monde entier. Mes frères avaient un groupe de musique et faisaient des reprises de chansons provenant de divers horizons. Ainsi, j’ai été exposée à différents styles musicaux, en plus de la musique traditionnelle du Bénin, de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique en général, et des artistes congolais, camerounais, togolais, et bien d’autres. Toutes les formes de musique existant à l’époque faisaient partie de mon quotidien.
J'ai toujours aimé chanter. J'ai commencé à chanter à six ans dans la troupe de théâtre de ma mère. Mais l’envie de devenir musicienne s’est cristallisée bien plus tard dans mon esprit.
On vous connaît comme une chanteuse engagée. On vous a donné sur le continent le surnom de Mama Africa. Qu'est ce qui, de vos racines fait de vous, cette artiste engagée ?
Moi, je suis partie du Bénin à l'âge de 23 ans. J'ai grandi dans une culture qui m'a toujours accompagné, peu importe où je suis allé. Je savais d'où je venais, même si je ne savais pas exactement où j'allais, ça, c'est certain. Mais ma culture, pour moi, n'a jamais été une question de choix : l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Elle fait partie de moi.
Je suis née avec cette culture. Dès mon enfance, j'ai été bercée par une grande diversité de musiques traditionnelles de mon village et de mon pays. J'étais aussi très curieux, je posais beaucoup de questions : pourquoi telle chanson existait, pourquoi pas telle autre, et quel était son rôle dans le contexte social. Pourquoi cette chanson avait été créée, d’où elle venait ?
J'ai toujours voulu comprendre cette richesse musicale traditionnelle, qui nous a été transmise à travers les siècles. Quand j'ai quitté mon pays, j'avais avec moi un bagage culturel profondément ancré dans la musique traditionnelle du Bénin, de la côte ouest-africaine, et même un peu plus largement du continent africain, car j'écoutais aussi des musiques venues d'ailleurs en Afrique.
Je suis partie avec ce bagage culturel, et jamais, absolument jamais, je n’ai eu l’intention de m’en éloigner.
Vous êtes une artiste très innovante en termes de production musicale, mêlant votre riche héritage culturel à une ouverture aux sons du monde.
À partir du moment où je suis arrivée en Occident, je me suis rendu compte que les musiques du continent africain sont au centre de toute la musique mondiale. L’esclavage n’a pas seulement représenté une perte économique pour l’Afrique, c’est aussi une perte culturelle immense. Mais cette perte n’est pas restée sur le continent ; elle a enrichi toutes les musiques du monde.
En arrivant, j’ai vu des gens classer les musiques par catégories, en disant : "Cette musique vient de tel endroit." Mais quand je ramène ces influences sur le continent africain, je retrouve leurs racines. J’ai réalisé cela pendant la création de ma trilogie d’albums. Ce voyage m’a permis de comprendre que de nombreux thèmes musicaux traditionnels sont restés intacts, même chez les descendants d’Africains réduits en esclavage.
Ces esclaves ont gardé dans leur mémoire des formes d’expression culturelle uniques, propres à l’Afrique. Aujourd’hui, on doit faire l’effort de redécouvrir ces musiques et leur complexité, ainsi que l’impact colossal des musiques africaines sur le monde. Prenons par exemple la musique classique : on parle souvent de la sarabande de Bach. Mais savez-vous que la sarabande a été influencée par les danses des esclaves du Panama ? Cette danse, arrivée à la cour d’Espagne, a été jugée trop sensuelle et renvoyée en Amérique latine. Mais elle est revenue en Europe sous une forme différente et s’est répandue partout.
C’est en menant ces recherches que j’ai compris à quel point la musique raconte l’histoire. Regardez le calypso : il trouve ses racines dans une pratique traditionnelle où deux villages en conflit se faisaient face de chaque côté d’une rue pour résoudre leurs différends en chantant. Ils exprimaient leurs griefs, leurs solutions, tout cela en musique. Le calypso est né de cette joute musicale.
Quand on connaît la richesse et la diversité de sa culture, on comprend que l’Afrique a toujours été un creuset d’influences. Les frontières actuelles n’effacent pas les similitudes qui existent dans les musiques de toute l’Afrique de l’Ouest. Ce que je fais à travers mes projets, c’est puiser dans ce creuset infini pour montrer les corrélations entre toutes ces expressions culturelles.
Par exemple, avec Yo-Yo Ma, nous avons travaillé sur un projet intitulé *Sarabande Africaine*. Ce que je veux dire, c’est que nous, Africains, ne sommes pas toujours conscients de ce que nous avons apporté au monde. C’est bien de parler des musées, mais il faut aussi écouter la musique. Sans le blues, pas de rock’n’roll. Pas de R&B. Pas de country. Pas de funk. Ces genres musicaux n’existeraient pas sans le blues, qui tire ses racines de l’Afrique.
C’est grâce à mon voyage musical que j’ai moi-même pris pleinement conscience de la richesse inestimable de la culture de mes ancêtres.
Parlons de votre voyage musical. Quel album, selon vous, représente le mieux l'aboutissement de cette diversité d'expériences, non comme une finalité, mais comme une parfaite illustration de votre parcours ?
Moi, je ne dirais pas que c’est un album, mais plutôt un travail constant, un fil conducteur qui remonte à mon tout premier album. Quand j’ai sorti Logozo en arrivant en France, certains journalistes ont critiqué, disant que ce n’était pas "suffisamment africain". Pour eux, pour que quelque chose soit africain, il fallait que ce soit uniquement anthropologique, traditionnel, figé, digne d’un musée.
Mais pour moi, il n’y a pas de musique traditionnelle sans modernité. La musique traditionnelle évolue avec le temps, elle s’adapte aux réalités de chaque époque. Ce qui est représentatif de ma vision, c’est la trilogie que j’ai entamée avec mes albums.
Dans cette trilogie, j’ai exploré différentes facettes de notre patrimoine musical.
Le premier volet m’a emmené aux États-Unis, où j’ai collaboré avec des auteurs et compositeurs afro-américains, blancs, de tous horizons. Ces échanges ont enrichi ma musique et m’ont permis de tisser des ponts entre l’Afrique et le monde.
Le deuxième volet m’a conduit à Salvador de Bahia, où j’ai découvert des pratiques religieuses et des chants traditionnels qui proviennent de mon propre pays. Ce qui m’a frappée, c’est que ces chants, transmis à travers les générations, étaient interprétés par des gens qui ne parlent ni le fon ni le yoruba, mais qui connaissent parfaitement ces mélodies. C’était une expérience bouleversante. La mémoire humaine est incroyable : malgré les tentatives d’éradiquer l’identité culturelle des Africains pendant l’esclavage, elle a survécu.
Le troisième volet m’a emmené dans les Caraïbes, où j’ai découvert des racines africaines dans des genres comme le calypso. J’ai découvert que ce type de chant existait déjà au Bénin. À Cuba, j’ai retrouvé les traces des cultures yoruba et béninoises, portées par des descendants d’Africains qui ont préservé leur héritage à travers les siècles.
Ces trois albums ont marqué une étape importante pour moi. Ils m’ont donné la conviction que plus personne ne pourrait dire que les Africains n’ont fait que "prendre". Non, nous avons donné, nous avons appris, nous avons mélangé, et ce mélange continue encore aujourd’hui.
Mon album Fifa est une autre illustration de ce retour aux sources. Je suis revenue au Bénin, j’ai voyagé du nord au sud, à la rencontre des tambours qui ont bercé mon enfance et nourri ma mémoire musicale. Ce voyage m’a confirmé une chose : aucune musique au monde ne peut exister sans la musique qui vient du continent africain.
L’Afrique est le berceau de l’humanité, mais on a tendance à l’oublier. Nous, Africains, avons un grand travail à faire pour aller à la source de ce que tout le monde revendique sans en connaître l’origine.
Mes collaborations, que ce soit avec des artistes ou en explorant les cultures noires à travers le monde, ne sont pas seulement transculturelles. Elles sont aussi transgénérationnelles. Mon travail est un hommage à notre héritage et un pont vers l’avenir.
Vous avez collaboré avec la jeune génération, comme les artistes nigérians ou encore récemment Stonebwoy au Ghana. Qu'est-ce qui vous pousse à vous tourner vers ces jeunes talents ?
Ce sont les jeunes qui se sont inspirés de moi, et je m'en suis rendu compte en devenant ambassadrice de l'UNICEF, lors de mes voyages dans des villages, notamment en Haïti. Là-bas, parfois, les gens ne se rappelaient même pas mon nom, mais ils se souvenaient de mes chansons. C’est à ce moment-là que j’ai pris conscience de l’impact de mon travail sur les jeunes, aussi bien les garçons que les filles.
Quand j’ai sorti mon premier album en France, on m’a dit que ma musique n’était pas "suffisamment africaine". Alors, j’ai posé une question au journaliste : « Pour vous, c’est quoi la musique africaine ? » Il m’a répondu : « La musique traditionnelle. » Je lui ai alors expliqué que la musique traditionnelle que je fais est moderne, parce qu’elle évolue avec le temps. Si elle n’était pas moderne, tous les artistes qui chantent la musique traditionnelle en Afrique seraient dans des musées. Pourquoi nous empêcher d’évoluer ? Pourquoi refuser de voir que nous utilisons aussi des outils modernes, comme l’électronique ?
Pour moi, l’idée de transmission transgénérationnelle est évidente. Nous venons tous d’une tradition orale. Ma musique, loin de laisser les jeunes africains indifférents, les pousse à réaliser ce qu’ils peuvent accomplir. Depuis des décennies, je dis toujours que le jour où la jeunesse africaine utilisera pleinement sa musique avec les technologies modernes à disposition, cela créera une vague déferlante.
Et c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui. Quand j’ai commencé, il fallait absolument signer un contrat avec une maison de disques pour exister. Cela avait un coût énorme, pas seulement financier, mais aussi personnel. Pourtant, ce que nous avons vécu à l’époque n’est rien comparé aux opportunités actuelles. Avec les outils numériques, ces jeunes peuvent aujourd’hui partager leur art sans limites.
Quand ils me contactent pour me dire : « J’ai grandi en écoutant ta musique, mes parents jouaient tes chansons », je leur réponds toujours ceci : Ne vous laissez pas définir par les clichés des autres. Peu importe qui vous êtes ou ce que vous voulez devenir, vous ne pourrez jamais plaire à tout le monde. Restez concentrés, disciplinés, et faites de votre mieux dans ce que vous entreprenez. Car même avant que votre travail ne soit vu, il y aura déjà des idées reçues à combattre.
Ce n’est pas facile pour nous, mais cela ne veut pas dire que c’est impossible.
Je voudrais maintenant parler de votre travail avec l’UNICEF et de ce qu’il représente pour vous.
En réalité, l’UNICEF a toujours fait partie de ma vie, sans que je m’en rende compte. Toutes mes vaccinations, quand j’étais enfant, ont été faites par l’UNICEF. Ma mère savait toujours quand le camion allait passer pour les vaccinations. Même si je détestais les piqûres à l’époque (et je les déteste toujours aujourd’hui), dans mon esprit, l’UNICEF représentait la santé, particulièrement celle des enfants.
Quand on m’a demandé de devenir ambassadrice de l’UNICEF, ma première question a été : "Qu’est-ce que cela signifie ?" Je leur ai dit tout de suite : "Je ne suis pas une politicienne et je ne peux pas être politiquement correcte. Si vous attendez cela de moi, je ne suis pas la bonne personne, car je dis les choses telles qu’elles sont."
On m’a alors demandé ce que je souhaitais faire. J’ai répondu : "Ce qui m’intéresse, ce sont les enfants—les jeunes garçons, les jeunes filles—et les femmes. Comment améliorer leur vie ?" C’est ainsi que tout a commencé, avec Carol Bellamy, par une mission en Tanzanie. Là-bas, j’ai découvert un orphelinat accueillant des enfants atteints du sida, des tout-petits qui n’avaient rien fait pour mériter cela.
Avec l’UNICEF, mon rôle est d’écouter et de travailler avec les communautés sur le terrain.
Y a-t-il une ou deux expériences marquantes de votre travail sur le terrain avec l’UNICEF que vous pourriez partager avec nos lecteurs ?
Je veux commencer par mon premier voyage en Tanzanie.
Dans un village, il y avait un taux très élevé de personnes atteintes de goitre. Nous avons mené une enquête pour comprendre pourquoi cette maladie était si présente uniquement à cet endroit. Nous avons découvert que c’était dû à la consommation de sel non iodé, ce qui amplifiait l’apparition du goitre.
Bien sûr, on aurait pu envisager des opérations pour traiter les cas, mais cela n’aurait pas résolu le problème à la racine. Alors, nous nous sommes demandé : Que faire pour prévenir cette maladie ? Nous avons travaillé avec une industrie pharmaceutique pour mettre au point des testeurs de sel, permettant aux femmes de vérifier si le sel qu’elles achetaient contenait de l’iode.
À partir du moment où les femmes ont eu ces testeurs, elles ont commencé à acheter uniquement du sel iodé. Les vendeurs, voyant que leur sel non iodé ne se vendait plus, sont venus demander comment en produire avec de l’iode. Petit à petit, toute la chaîne a changé, des acheteurs aux vendeurs, et nous avons observé une diminution progressive du goitre dans ce village.
Cela a été possible sans avoir besoin d’amener les gens en dehors de leur village pour des opérations chirurgicales lourdes. Nous avons trouvé une solution simple, locale et durable.
Un autre exemple est celui de la malnutrition dans le district de Samburu, au Kenya. Nous avons visité deux villages : l’un où un programme de lutte contre la malnutrition était bien avancé, et l’autre où ce programme n’avait pas encore commencé.
La différence entre les deux villages était frappante. Dans le village où le programme était implanté, les femmes et les enfants étaient en bien meilleure santé. Mais dans le second village, nous avons vu une mère enceinte de cinq mois, avec un enfant de 24 mois qui n’arrivait pas à s’asseoir ni à tenir sa tête.
Cela montre que lorsque nous aidons les gens à prendre en main leur propre santé, les résultats sont incroyables. Les mères, une fois formées et soutenues, se mobilisent. Elles nourrissent leurs enfants, leurs familles et leurs communautés.
C’est en leur donnant les moyens de se responsabiliser que nous pouvons faire une différence durable.
Que ce soit artistiquement ou dans votre rôle d’ambassadrice de l’UNICEF, quels sont vos projets ?
Un prochain album sortira en février, et on verra comment il sera accueilli. Je suis toujours en train de créer, de travailler sur de nouvelles choses.
En ce moment, par exemple, je travaille sur un opéra. Je suis constamment dans la création, car pour moi, tant qu’on est vivant, qu’on a des idées et qu’on a l’opportunité de les réaliser, il faut en profiter. C’est aussi une manière d’ouvrir des portes à d’autres personnes.
Quant à mon engagement avec l’UNICEF, je crois que je resterai engagée avec cette organisation jusqu’à la fin de ma vie. Tant qu’il y aura dans le monde des gouvernements et des sociétés incapables de protéger les droits des enfants, je continuerai à soutenir l’UNICEF.
Un souhait particulier pour votre continent ?
L’Afrique est le continent qui compte le plus de jeunes de moins de 19 ans. Le XXIᵉ siècle sera le siècle de l’Afrique, si et seulement si nous prenons conscience de nos besoins et y répondons nous-mêmes, sans attendre de tuteurs.
L’Afrique est un continent riche, et nous devons donner de la fierté à notre jeunesse, créer des emplois pour qu’ils puissent rester chez eux, au lieu de risquer leur vie sur des embarcations de fortune. C’est une honte de voir ces jeunes partir, et pourtant nous sommes capables, en Afrique—que ce soit au nord, au centre, au sud, à l’est ou à l’ouest—de leur offrir des raisons de rester.
Nous devons encourager nos enfants, filles comme garçons, à bâtir leur avenir chez eux, à ne pas partir comme je l’ai fait, sans perspective. Nous avons les talents, et il est impératif de les garder en Afrique pour construire un continent tourné vers l’avenir, et non enfermé dans le passé.
Mon rêve pour le continent africain est que nous nous levions, que nous soyons debout, et que nous décidions de créer des entreprises, de produire et de développer nos ressources sur place. Nous devons impérativement atteindre une indépendance alimentaire, une indépendance en matière de défense, et une indépendance scientifique pour pouvoir résoudre nos propres problèmes de santé. Nous devons mener des recherches sur les maladies qui nous touchent directement.