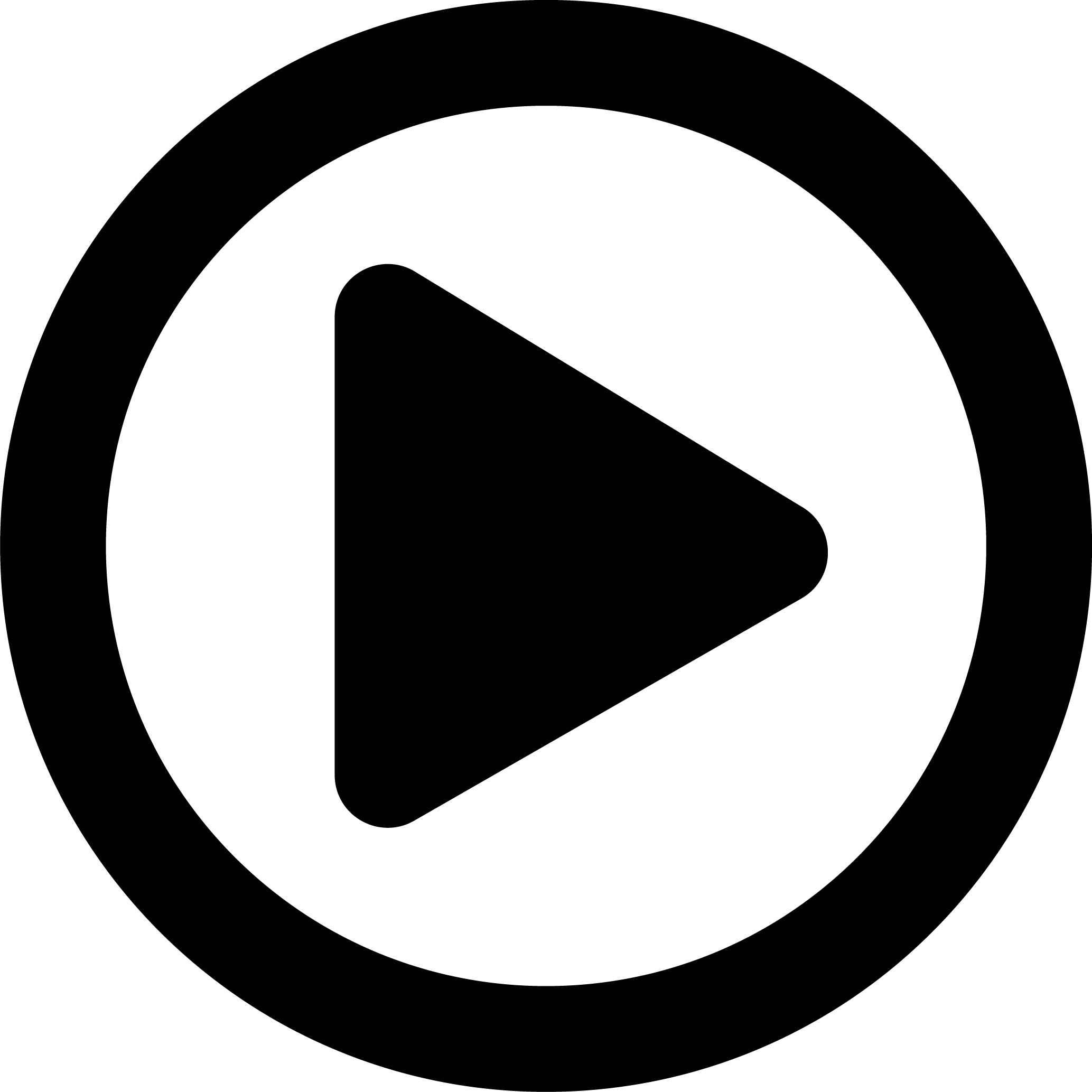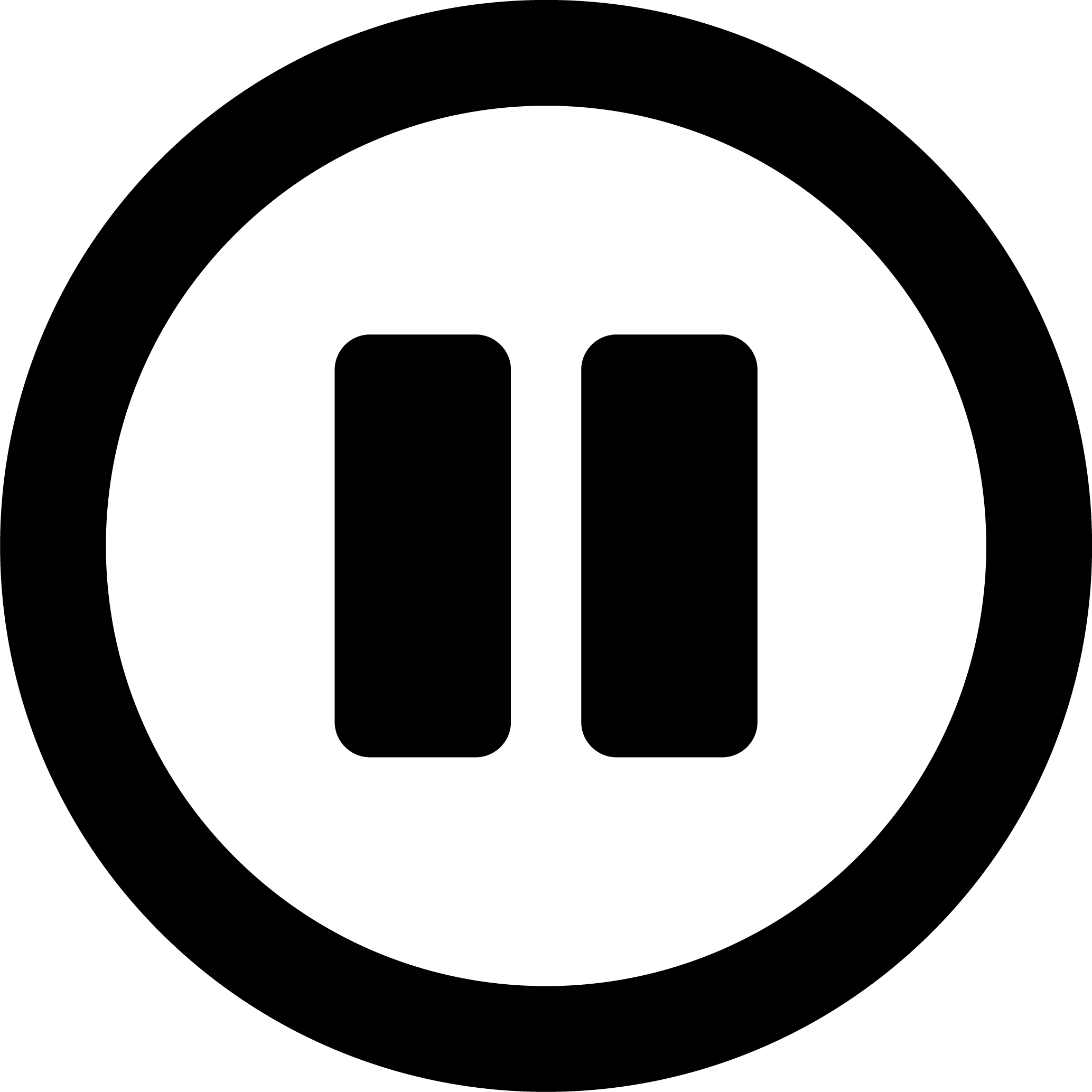Sur tout le continent, les Africains économisent et investissent aujourd’hui une plus grande proportion de leur propre argent mais cette épargne s’est détournée des banques. Selon la Commission économique pour l’Afrique (CEA) de l’ONU, le taux d’épargne intérieur de la région est passé de juste 19 % du produit intérieur brut (PIB) en 1998–2001 à 26 % en 2007. Selon une étude publiéeen mars 2008 par la CEA, le taux d’investissement intérieur de l’Afrique a également augmenté de 19,7 % à 22,1 % sur la même période.
Au Kenya et dans d’autres pays africains, ce sont des de clubs locaux non institutionnels qui ont aidé à orienter l’épargne vers des investissements productifs. Actuellement, ces groupes locaux détiennent un total d’environ 35 milliards de shillings kényans (KSh), l’équivalent de 469 millions de dollars américains. Ce n’est là qu’une petite portion du total de 642 milliards des dépôts bancaires du Kenya en 2007, mais néanmoins plus du double de toutes les aides financières étrangères reçues par le pays l’année dernière.
Les Kényans appellent ces clubs des chamas, ce qui peut se traduire par “comités”. Ils ont été créés pour faire face aux turbulences économiques des années 1980 et 1990. Dans ces chamas, les membres d’une famille, les voisins ou les collègues de travail mettaient en commun leurs ressources et utilisaient cet argent pour financer des prêts et des emprunts entre les membres du groupe durant les périodes difficiles. Quand la santé économique du pays s’est améliorée, les membres ont utilisé ces fonds pour créer de petites entreprises.
Progressivement, ces clubs ont commencé à s’institutionnaliser et certains d’entre eux se sont transformés en société pour investir dans des actions et dans l’immobilier. Selon M. Kariuki, de Kenyan Association of Investment Group, un Kényan adulte sur trois est aujourd’hui membre d’un club d’investissement. “Nous pensons que ces clubs ont un énorme potentiel. Si les capitaux qu’ils détiennent sont correctement utilisés, cela aiderait considérablement le pays”, a-t-il déclaré à Afrique Renouveau.
Les coopératives d’épargne et de crédit
Les clubs d’épargnants ne sont pas une nouveauté au Kenya. Des institutions tournées vers l’épargne nationale existent sous des formes plus officielles depuis la fin des années 1970 et au cours de cette période un grand nombre d’agriculteurs, d’enseignants, de médecins et de membres d’autres professions ont formé des mutuelles ou des coopératives d’épargne et de crédit (COOPEC) ainsi que d’autres types de coopératives. On estime que ces établissements détiennent aujourd’hui un total de 130 milliards de KSh (1,7 milliards de dollars U.S.) en fonds d’épargne.
A la différence des clubs d’investissement dont tout un chacun peut devenir membre, la plupart de ces mutuelles et coopératives limitent en général leurs adhérents à une profession définie. La coopérative Mwalimu s’adresse par exemple aux enseignants du secteur public. Et alors que les clubs d’investissements se consacrent à recueillir l’épargne à des fins d’investissement, les COOPEC, comme les fonds de pension, ne peuvent pas légalement se livrer à des activités commerciales qui pourraient exposer l’argent des membres à des risques indus.
Selon James Mwangi, directeur général d’Equity Bank Kenya, le principal obstacle à l’utilisation des COOPEC comme instruments d’investissement viables a été la médiocrité de leur gestion. “La structure de gouvernance des coopératives a été un gros problème et plus un handicap qu’un avantage”, a-t-il déclaré à Afrique Renouveau. “Il y a eu beaucoup d’abus de la part de responsables et des gens ont perdu leur argent.” Ce problème “a failli tuer la culture de l’épargne”, explique M. Mwangi, et poussé beaucoup de personnes à garder leurs économies en liquide.
Des modèles et des sources d’inspiration
Certains des clubs d’investissement prouvent qu’une bonne gestion est possible. Alliance Capital Partners (ACP) a été formé pour investir dans l’immobilier, ses membres ont rassemblé eux-mêmes autant du capital nécessaire qu’ils pouvaient et ont ensuite utilisé cet argent pour obtenir un financement bancaire complémentaire. Ils ont construit à ce jour un hôtel de 49 chambres et deux immeubles résidentiels de 17 appartements locatifs chacun et font actuellement construire un troisième immeuble de 80 appartements.
“L’utilité d’un club est qu’il vous permet de mettre en commun vos ressources”, a déclaré à Afrique Renouveau Antony Mwaniki, un membre d’ACP. “Cela ouvre des possibilités d’investissements plus considérables à tous les membres. Une transaction qui serait hors de portée pour un particulier devient tout à coup possible pour tout le monde dans le groupe.”
M. Kariuki note que le succès de telles initiatives a été variable. “Ordinairement, les clubs ont un taux de réussite de 50 %. Mais, ajoute-t-il, la plupart détiennent un capital inférieur à 1 million de KSh. Selon lui, les mauvaises structures de direction sont une des principales raisons de l’échec de nombreux clubs.
Aider les clubs à surmonter ces problèmes a été ce qui a motivé la formation de KAIG, explique M. Kariuki. “Nous voulions aider les clubs en leur fournissant des informations, par exemple comment former le club correctement et quels types de règlement et de principes directeurs les aideraient à réaliser leurs objectifs. Nous organisons régulièrement des réunions où des invités viennent leur parler de perspectives d’investissement.”
Ces clubs commencent à rencontrer les mêmes problèmes que les institutions commerciales y compris, note M. Mwaniki, “les risques politiques”. L’année dernière, son groupe ACP a proposé un placement à un investisseur britannique qui les soutient et qui envisageait d’investir jusqu’à 1 million de dollars. “Mais cet intérêt s’est immédiatement évaporé quand ont éclaté les violences post-électorales du début de l’année.” Selon lui, les gouvernements africains “doivent comprendre que les crises politiques, même de courte durée, ont une profonde influence sur la manière dont nous pouvons présenter nos perspectives d’investissement aux marchés internationaux”. Selon lui, il faut que le gouvernement mette en place un cadre institutionnel solide et fasse appel à la diaspora kenyane.